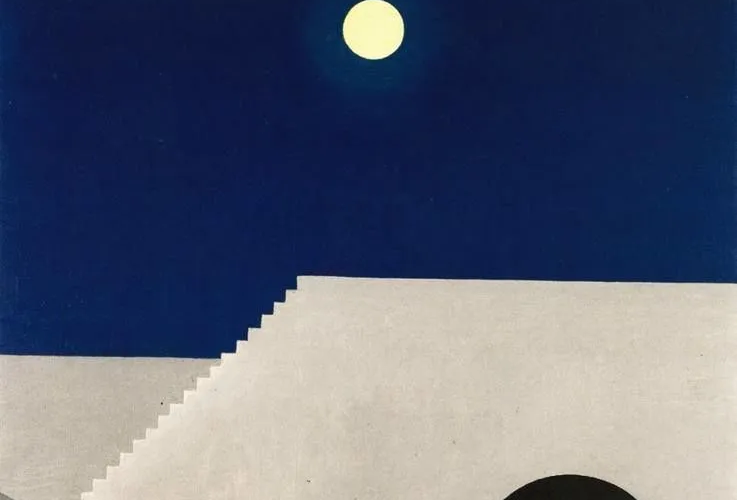La France a enfin un budget pour 2025 et le moment est venu de dresser un premier bilan, notamment sur les coupes écologiques. Cette note montre que dans une situation de tensions budgétaires, tant qu’il n’y aura pas de planification du financement de la transition écologique avec une véritable discussion sur les ressources, les dépenses vertes resteront fortement exposées aux aléas des coupes. Le dernier budget de l’État illustre bien ce phénomène.
Pour commencer, quelques chiffres généraux sur le scénario économique. Ce budget se veut plus réaliste que celui de Michel Barnier, avec une prévision de déficit qui a été revue de 5 % à 5,4 % (alors que celui-ci avait atteint 6 % en 2024). La croissance, elle, a été abaissée et passe 1,1 % à 0,9 %, ce qui est plus en ligne avec les prévisions d’organismes externes comme l’OFCE (voir notre lettre sur le sujet). Cependant, le Haut Conseil des Finances Publiques a publié son avis et juge que la prévision de croissance reste légèrement optimiste, tout comme la prévision de déficit, qui s’appuierait sur un scénario macroéconomique trop favorable et des mesures d’économies qui restent à confirmer. Enfin, selon les prévisions du gouvernement, la dette publique devrait atteindre plus de 115 % du PIB en 2025 (contre 112,6 % en 2024) ; il s’agit du point haut atteint pendant la crise sanitaire. Cette prévision se situe cinq points au-dessus des prévisions de la Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP), une dégradation que ne manque pas de souligner le HCFP.
Ce scénario est fragile malgré des efforts d’économies conséquents : une trentaine de milliards d’euros qui portent essentiellement sur les dépenses de l’État. En tenant compte de la hausse des dépenses sociales et des collectivités, les dépenses publiques devraient progresser de 43 Md d’euros, atteignant 1 695 Md d’euros, une hausse autour de 1 % en volume. Le poids des dépenses publiques progresse très légèrement à 56,7 % du PIB [1], loin de leur pic de 61 % en 2020.
Mais où sont les coupes ? L’écologie est sacrifiée, malgré les apparences. Dans le texte datant du 31 janvier, le programme « Écologie, développement et mobilités durables » était l’un de ceux qui connaissait la baisse la plus importante de crédits : 2,1 Md d’euros en crédits de paiement par rapport à la Loi de finances de 2024, soit 10 % du budget de la mission. Cependant, un amendement comptable de dernière minute est venu rajouter 2 Md à ce programme. Il s’agit d’un abondement du gouvernement aux crédits du poste « Service public de l’énergie », mais qui ne signifie pas davantage de soutien aux énergies propres. Celui-ci est passé de 6,7 à 8,9 Md, ce qui s’explique par une hausse des compensations versées aux fournisseurs d’énergies renouvelables. Cependant, il ne s’agit pas d’une hausse des investissements, mais d’un effet de l’évolution des prix de l’électricité (baisse des prix de gros de l’électricité et du gaz qui creuse l’écart avec le tarif garanti) qui mène à une hausse automatique des dépenses de soutien.
Ce changement masque des coupes importantes. En dehors de ce poste, les réductions sont de 3,6 Md sur l’ensemble des autres missions du programme (voir Tableau 1). Au sein du programme, l’un des postes les plus touchés est celui qui concerne la biodiversité (qui perd presque 20 % de son budget). En valeur absolue, c’est le poste « Energie, climat et après-mines » qui est érodé (- 4 Md), alors qu’il s’agit d’un programme qui comporte de nombreuses dépenses d’intervention (sortie des énergies fossiles, prime à l’achat d’un véhicule électrique, fonds chaleur de l’Ademe, etc.).
Tableau 1 – Évolution des crédits de paiement de la mission Écologie, développement et mobilités durables
Sources : Loi de finances 2024, PLF du 3 février sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité (crédits de paiement).
Mais toutes les dépenses écologiques n’apparaissent pas dans cette mission. En dehors du programme, les 1,1 Md consacrés à l’écologie du plan de relance disparaissent. Dans la mission agriculture, le poste « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt » passe de 2,7 Md en 2024 à 2,3 Md en 2025. Nous pouvons également noter que le budget de MaPrimeRenov’ a été transféré dans le programme « cohésion des territoires », ce qui explique en partie la baisse du programme écologie, mais celui-ci a par ailleurs été significativement réduit (voir Tableau 2). Selon I4CE, la dotation de l’État à l’Agence National de l’Habitat (ANAH) a baissé (3,7 Md en LFI 2024) et retrouve son niveau de 2023 (2,3 Md) [2] ; elle devra donc puiser dans sa trésorerie.
Hors ajustement du poste « Service public de l’énergie », la mission écologie fait donc partie des plus touchées. Plus largement, si l’on met de côté les engagements financiers de l’État, dont la baisse importante s’explique par la chute des taux, les programmes du budget les plus coupés ont été « France 2030 » (-2,4 Md) et « Travail et emploi » (-2,7 Md), notamment en raison de la diminution de la prime à l’embauche des apprentis. À l’inverse, les missions dont les crédits ont le plus augmenté sont la Cohésion des territoires (+3,9 Md) et la défense (+3,2 Md, loi de programmation militaire).
Nous avons recensé ci-dessous les annonces disponibles sur les ajustements écologiques. C’est lors de la discussion au Sénat que les politiques écologiques ont été plus rabotées que prévu, avec des réductions qui touchent principalement MaPrimeRenov’, l’électrification des véhicules et le soutien aux énergies renouvelables.
Tableau 2 – Ajustements des politiques écologiques
Sources : I4CE, Les Échos, Le Monde, Reporterre.
Ces ajustements budgétaires sur l’écologie contrastent significativement avec les chiffres affichés par le gouvernement, qui estime lui-même les besoins supplémentaires pour l’ensemble de l’économie à +110 Md€ en 2030 par rapport à 2021. Nous nous éloignons ainsi toujours plus de la réalisation de nos objectifs de réduction d’émission [3]. Pour conclure, dans une situation de tensions budgétaires, tant qu’il n’y aura pas de planification du financement de la transition écologique avec une véritable discussion sur les ressources, les dépenses vertes resteront fortement exposées aux aléas des coupes. Le dernier budget de l’État illustre bien ce phénomène.
Clara Leonard
Note : nous avons travaillé avec les dernières données disponibles, celles-ci sont susceptibles d’évoluer ou d’être précisées.
Image : René Magritte, Architecture au clair de lune, 1956, huile sur toile, 65 x 50 cm.
A lire aussi :
- Un potentiel en sursis ? Règles budgétaires et capacités productives
- PLF et règles budgétaires européennes : un ajustement prématuré ?
- Comment ajuster ? Commentaire de la note du CAE : « Quelle trajectoire pour les finances publiques françaises ? »
- L’État français risque-t-il de faire faillite ?
Notes
[1] Hors crédits d’impôt.
[2] En autorisations d’engagement.
[3] Pour une recension des besoins de financement en France et en Europe, vous pouvez consulter notre article sur le sujet.