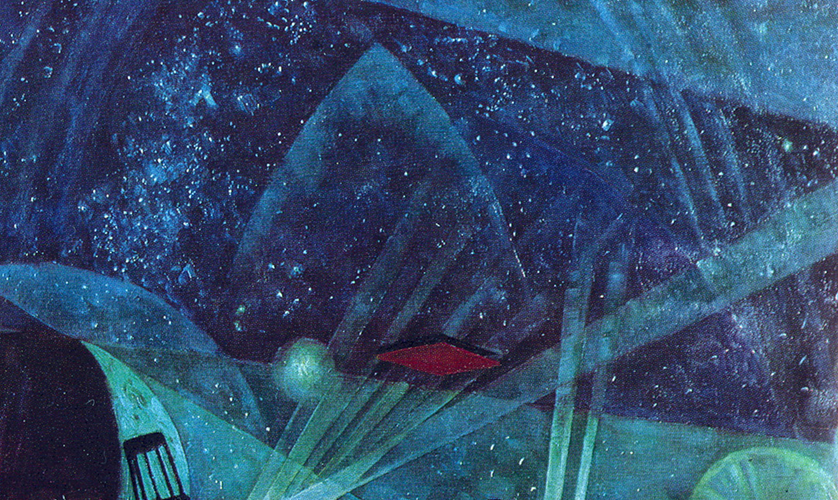Le système de financement public que nous connaissons actuellement, caractérisé par un instrument dominant – la vente aux enchères de bons du Trésor sur les marchés financiers internationaux –, n’a pas toujours été. En nous appuyant sur une diversité d’archives [1], nous montrons que trois doctrines de la dette publique ont existé et successivement dominé en France au XXe siècle : la doctrine « libérale », « circuitiste » et « néolibérale ».
Qu’est-ce qui les différencie ? Comment sommes-nous passés d’une doctrine à une autre ? Cette note met en lumière la richesse historique des modes de gestion de la dette publique et vise à populariser un nouveau récit sur l’histoire de la dette publique française. Sans affirmer qu’il faut copier tels quels les outils de dette historiques, cette analyse permet de comprendre comment nous avons pu faire face à de forts accroissements des besoins de financement. Elle invite à prendre du recul dans un contexte où le financement de la transition écologique est l’un des grands enjeux contemporains.
Qu’est-ce qu’une doctrine économique ?
En s’appuyant sur l’Histoire des doctrines économiques de Charles Gide et Charles Rist (1944), on peut considérer qu’une doctrine est « ce mélange indissociable » de « croyances et des opinions » et de « science économique stricto sensu » [2]. Pour les caractériser, il faut identifier trois composantes : tout d’abord, des conceptions économiques normatives qui portent sur des principes fondamentaux tels que le rôle de l’État, des marchés ou la gestion de la monnaie ; des théories, ensuite, « un ensemble de propositions logiquement liées entre elles et susceptibles d’être considérées comme vraies ou fausses » [3] (par exemple sur le lien entre inflation et financement public) ; enfin, nous pouvons enrichir le concept de doctrine d’une troisième dimension : les pratiques économiques. Par exemple, dans le cas de la dette, le choix de s’endetter plutôt à long ou à court terme, à taux variable ou à taux fixe etc.
En construisant un cadre analytique autour des doctrines, nous parvenons à deux conclusions. Tout d’abord, des discussions en apparence technique sur le choix des instruments de financement sont en réalité sous-tendues par des conceptions normatives autour du modèle économique et de société. Ensuite, ces trois dimensions n’évoluent pas nécessairement au même rythme, comme l’illustre histoire de la dette que nous nous apprêtons à retracer. Une doctrine économique se forme seulement quand elle se met à combiner ces trois dimensions, et elle devient « dominante » lorsqu’elle guide les politiques économiques, c’est-à-dire quand le champ décisionnaire s’y convertit, l’administration et le gouvernement.
La doctrine libérale (XIXe siècle – 1939)
Au XIXe siècle en France, l’État s’endettait essentiellement par rentes perpétuelles [4], mais au moment de la Première Guerre mondiale, le Trésor se mit à émettre des bons du Trésor à court terme pour financer la guerre. Peu rompu à la gestion de ce genre d’instruments, il fit l’expérience de crises de trésorerie à répétition pendant les années 1920. En réaction, les défenseurs de la doctrine libérale du financement public prônèrent une éradication de la dette à très court terme dite « flottante » [5]. Le plan de « stabilisation » de Raymond Poincaré est moins connu sous son autre nom, celui de plan « d’assainissement » (1926-1928). Pourtant, il s’agit d’une dimension tout aussi importante des politiques de cette époque. Celui-ci fut mis en place avec pour objectif de réduire le déficit budgétaire et d’allonger la maturité moyenne de la dette publique (la « consolider »). La part de la dette flottante et à court terme dans la dette intérieure diminua fortement entre 1924 et 1931. Elle passa de 45% du total à moins de 20 %, pour augmenter à nouveau à partir de la deuxième moitié des années 1930 (Graphique 1).
Graphique 1 – Évolution de la part de la dette flottante et à court terme dans la dette intérieure (%), en ajustant pour inclure les avance
Notes : les données utilisées pour effectuer l’ajustement sont celles de Patrice Baubeau, « The Bank of France’s Balance Sheets Database, 1840-1998. An Introduction to 158 Years of Central Banking », Financial History Review, 25 (2), 2018, p. 203-230. Il s’agit des données officielles du bilan de la Banque à l’époque.
Source : calculs effectués à partir des annuaires de la Statistique Générale de la France de 1924 à 1939.
Qu’est-ce qui mena à ce choix spécifique de mode de gestion de la dette publique ? Sur le plan des théories, les libéraux (métallistes [6] et quantitativistes [7]) considéraient tous que la dette à court terme était plus inflationniste qu’à long terme, car elle créait davantage de monnaie. Et quelles étaient leurs conceptions normatives ? ils jugeaient que les dépenses de l’État devaient être minimales, celui-ci devant se contraindre pour réduire sa dette à court terme. Cependant, ces caractéristiques générales n’empêchèrent pas de vives controverses entre libéraux.
Le courant libéral se divisa en deux pendant l’entre-deux-guerres autour de la question de la place à donner à la dette à court terme. D’un côté, les libéraux réformateurs (Pierre Quesnay [8], Jean Tannery [9] ou Jacques Rueff [10]), influencés par des voyages à Londres, se mirent à défendre l’adoption de pratiques britanniques jugées novatrices à l’époque telles que l’adjudication de bons du Trésor ou les opérations d’open market de la banque centrale. Même s’ils défendaient en partie la consolidation, ils jugeaient que la dette à court terme avait un rôle à jouer, et leur objectif était que le marché monétaire français se développe en se rapprochant du système britannique.
C’est à cette époque et dans cette branche que naquit le concept de « discipline de marché » sous sa forme première : l’idée qu’en soumettant le financement public aux conditions de marché, la limitation de l’endettement ne dépendrait plus de la volonté de l’État, incertaine, mais qu’elle serait constamment permise par le marché. Cette idée émergea chez les libéraux réformateurs, qui pourraient aussi être qualifiés de proto néolibéraux et qui souhaitaient développer le marché monétaire français, à l’époque bien moins liquide qu’outre-Manche. Selon eux, c’était le libre jeu de l’offre et de la demande sur un marché liquide qui pouvait permettre de définir « la valeur » de l’argent. Pierre Quesnay, personnage le plus emblématique de ce courant, ne donna toutefois pas de définition de ce qu’il jugeait être une juste valeur. Il affirma simplement, de manière relativement arbitraire, que l’État s’endettait à trop bon marché.
Mais ce fut l’autre sous-courant qui domina, celui des libéraux traditionalistes (Charles Rist [11] ou Robert Lacour-Gayet [12]), ancrés dans la tradition métalliste française du XIXe siècle. Ces derniers s’inquiétaient davantage des effets de la dette flottante. Ils voulaient l’éradiquer intégralement et ils étaient moins convaincus du potentiel des techniques britanniques. Ils cherchaient en priorité à réduire les bons du Trésor à court terme plutôt que les avances directes de la Banque de France. En effet, les bons étaient vues comme un danger plus important dans un contexte de crises de trésoreries et les avances étaient plus traditionnellement utilisées en cas de crise. Le plan d’assainissement Poincaré eut pour fondement intellectuel les théories de cette deuxième branche, et il visait par conséquent à un retour au mode de gestion de la dette publique qui dominait au XIXe siècle.
La doctrine circuitiste (1939 – milieu des années 1960)
En parallèle, une nouvelle doctrine de la dette émergea pendant l’entre-deux-guerres, que nous pouvons qualifier de « circuitiste ». Celle-ci est caractérisée par une diversification des modes de financement public, une grande partie du financement devenant hors marché. Petit à petit, elle s’érigea en véritable doctrine concurrente. Peu après l’entrée en guerre de la France, le ministre des Finances Paul Reynaud prononça un discours à la Chambre des députés et présenta cette doctrine comme une arme de guerre pour vaincre Hitler. On peut considérer qu’il s’agit du point de départ officiel de l’adoption du circuitisme comme mode de gestion de la dette publique :
« L’État, messieurs, va jeter dans le pays, pour les dépenses de guerre, des milliards, des milliards, des milliards. Si tous ces milliards servaient à des dépenses de consommation, ce serait bientôt la vie infiniment chère. (…). Si pour l’une de ces deux raisons, ou pour l’autre, ces milliards ne revenaient pas, sous forme d’épargne et de souscriptions dans les caisses du Trésor, celui-ci devrait faire imprimer de nouveaux milliards. (…) Je viens ainsi de démontrer, messieurs, la nécessité du circuit que rendent possible, en temps de guerre, notre politique des prix et notre politique des changes. » (Reynaud 1939).
Cette doctrine devint dominante pendant la Deuxième Guerre mondiale et elle permit ensuite de financer la Reconstruction. Jusqu’à maintenant, cette phase de l’histoire de la dette française a été traitée comme une parenthèse historique qui se serait nichée entre une gestion « libérale » et « néolibérale » de la dette publique, qui s’inscriraient toutes deux en grande partie dans une même continuité. Nous remettons en question ce postulat important : l’idée que le circuit pourrait être réduit à de simples pratiques propres au conflit, qui n’auraient été associées à aucune architecture intellectuelle particulière. La première, défendue par les historiens de l’économie, consiste à y voir l’agrégation chaotique d’une série de pratiques (Quennouelle-Corre 2001 ; Margairaz 1991). La deuxième ; privilégiée par les économistes, interprète cette période comme un épisode classique de « dominance budgétaire » [13] (Sargent & Wallace 1981) ou de « répression financière »[14] (Reinhart & Sbrancia 2015 ; Eichengreen & Esteves 2022 ; Baubeau et Le Bris 2017). En substance, le circuitisme n’a jamais été pensé comme une doctrine à part entière, qui alla de pair avec une évolution de la conception de l’État.
Mais l’histoire du circuit n’est pas linéaire, et cette doctrine a été adoptée par des acteurs d’une grande diversité, tant sur le plan sociologique (experts de l’administration, journalistes, universitaires etc.) qu’idéologique. En effet, ces mécanismes furent aussi bien portés par des économistes ou des hauts fonctionnaires qui soutenaient ou participaient au régime de Vichy, et qui prétendaient qu’ils étaient d’inspiration allemande, que par des membres de la Résistance et des planistes qui souhaitaient pérenniser le circuit après la guerre.
Dans les années 1920, les premiers circuitistes partirent du même constat que les libéraux : la dette à court terme peut être inflationniste et poser des difficultés de refinancement. Cependant, leur solution à ces deux problèmes ne fut pas son éradication, bien au contraire. Pour éviter les crises de trésorerie, ils se mirent à considérer qu’une part du financement public devait se faire hors marché, et ils imaginèrent des mécanismes automatiques de captation des ressources.
Le financement « hors marché » peut être entendu au sens large comme tout mécanisme qui influerait sur les conditions de financement public grâce à une réglementation ou à l’intervention d’une institution publique. C’est par exemple le cas lorsque le Trésor fixe les taux des bons du Trésor[15], lorsque la Banque de France influe sur la liquidité des bons du Trésor grâce à diverses opérations, effectue des prêts directs ou indirects à l’État ou encore lorsque des lois imposent l’achat par les banques d’une certaine proportion de bons du Trésor. Selon cette définition, l’assouplissement quantitatif mis en place par les grandes banques centrales qui s’est progressivement banalisé depuis la crise de 2008 serait par exemple finalement une forme de financement hors marché.
Mais il peut être également entendu au sens strict comme la redirection automatique vers les caisses du Trésor, de l’épargne déposée chez les correspondants du Trésor [16]. Cet « art de la trésorerie », théorisé par Alfred Pose, Henri Maleprade ou encore Francis Delaisi, consistait à capter l’ensemble des liquidités mises en circulation par le déficit budgétaire. Ainsi, la part de la dette sur le marché est progressivement devenue faible, proche de 30 % après la Deuxième Guerre mondiale (Graphique 2).-
Graphique 2 – Part de la dette sur le marché en France (% du total)
Notes : En 1939, cette proportion était plus importante qu’après la mise en place du circuit, de 44%, données de United Nations, statistical yearbook.
Source : Ministères des Finances, base de données de S.M. Ali Abbas, Laura Blattner, Mark de Broeck, Asmaa El-Ganainy and Malin Hu, “Sovereign Debt Composition in Advanced Economies: A Historical Perspective”, IMF working paper No. 2014/162, 2014. Leurs sources sont les suivantes : annuaire de la Société des nations (1914-1945), statistiques officielles du ministère des Finances (1945-2011).
En démêlant les trois fils évoqués précédemment, on observe des évolutions asynchrones :
- Pratiques
Les premières expériences d’automatisation du financement public se firent pendant l’entre-deux-guerres. L’objectif était de faire dépendre le moins possible le financement public des comportements aléatoires des investisseurs. La politique Pierre-Etienne Flandin [17] en 1935 constitue un bon exemple de politique circuitiste. Dans un contexte de forte concurrence entre les besoins publics et privés, il voulut soulager le marché monétaire. Pour ce faire, le Trésor augmentera l’émission de bons du Trésor et demanda secrètement aux banques commerciales de lui en acheter à très court terme et de les réescompter directement à la Banque de France.
Mais c’est pendant la Deuxième Guerre mondiale que le circuit cessa d’être une simple expérience ponctuelle pour devenir un système. La part de la dette emblématique du circuit [18] passa de 31 % à 67 % avant et après la guerre. L’augmentation de ces deux postes explique près de 90 % de l’augmentation de la dette publique totale entre 1939 et 1944 et elle servit à financer des frais d’occupation exorbitants imposés par le régime nazi. Mais le circuit n’était pas un système qui se limitait à la création monétaire. Pour éviter que cela soit inflationniste, diverses techniques furent utilisées. Une promotion importante du bon du Trésor comme instrument de régulation, tout d’abord. Des mesures visant à réduire les transactions en francs et la consommation, ensuite. Enfin, en 1941, une réforme bancaire modifia les relations entre les banques et l’État, semi-corporatiste et semi-Etatiste. Le placement de bons du Trésor à court terme fut alors facilité par le contrôle des bilans des banques. Avant la guerre, ils représentaient entre 30 et 40 % des portefeuilles des banques. A la fin de 1941, 80 %, et en juin 1943, 90 %.
Après la Deuxième Guerre mondiale, le circuit fut organisé pour être compatible avec une reprise de la consommation. Une loi cruciale pour l’optimisation future de la fermeture du circuit fut votée le 2 décembre 1945 : la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques commerciales [19]. L’un de ses objectifs affichés était de « diriger l’épargne nationale vers les vastes investissements qu’exige la reconstruction du pays après la Deuxième Guerre mondiale », comme le souligna le Général de Gaulle en mars 1945 dans un discours devant l’assemblée consultative.
L’ordonnance du 13 avril 1945 [20] fut également importante pour l’institutionnalisation du circuit du Trésor. Depuis le décret du 13 septembre 1914, le Trésor pouvait émettre de manière permanente et sans plafonnement des bons auprès du grand public, mais cette ordonnance créa une nouvelle catégorisation des bons du Trésor. Elle dissocia ceux qui furent qualifiés de « sur formules », destinées au grand public, et les bons « en compte courant », destinés aux organismes financiers. L’obligation fut également formulée pour certains établissements de déposer en compte-courant leurs bons du Trésor à la Banque qu’ils détenaient en portefeuille [21]. Enfin, en septembre 1948, les banques commerciales furent tenues de détenir une quantité minimale déterminée de titres d’État (appelée « plancher ») égale à 95 % du montant détenu par chaque banque en septembre 1948, ce qui constitua un tournant. Les banques devaient également dédier un cinquième de leurs nouveaux prêts aux obligations du Trésor.
Enfin, dans les années 1950, différents moyens de financement par la Banque de France se développèrent (Monnet 2018). L’État demanda notamment à ses satellites, des institutions telles que la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) ou le Crédit Foncier, de lui prêter de l’argent en ayant recours à cette méthode. La partie cachée du financement s’est faite principalement par deux types de crédit : les obligations cautionnées [22] et les prêts à la construction de la CDC.
- Théories
A rebours de la manière dont le circuit a été appréhendé dans la littérature et par ses détracteurs de l’époque qui ont poussé à son démantèlement, l’étude des archives permet de conclure que les circuitistes se préoccupaient de l’inflation. Mais à l’inverse des libéraux et des néolibéraux, s’ils jugeaient que certains modes de financement public étaient davantage créateurs de monnaie que d’autres, ils considéraient que l’État n’est pas le seul coupable. Ils ne stigmatisaient pas le financement public comme étant plus dangereux que d’autres formes de financement, et ils n’établissaient pas de lien automatique entre les dépenses publiques et l’inflation.
Pour les libéraux et les néolibéraux, la désinflation ne pouvait être réalisée qu’en rétablissant l’« équilibre budgétaire ». Les circuitistes se préoccupaient davantage de l’« équilibre de trésorerie ». Assurer cet équilibre signifiait s’assurer que le déficit budgétaire soit couvert par des moyens de financement public, alors qu’assurer l’équilibre budgétaire revenait à faire en sorte que ce déficit budgétaire n’apparaisse pas. Ils considéraient que l’inflation pouvait être réduite grâce à des « ponctions » de liquidités, opérées grâce aux bons du Trésor, qui ne permettaient pas seulement d’assurer le financement public, mais qui jouaient également un rôle régulateur. Selon eux, le financement public pouvait être inflationniste seulement s’il était mal géré, c’est-à-dire si le circuit ne se « fermait » pas. Pour éviter que le financement public ne soit inflationniste, ils développèrent ainsi une conception nouvelle du bon du Trésor à court terme : en plus de permettre le financement public, il jouait un rôle de régulation de la liquidité.
Le circuit ne fut pas une simple agrégation de pratique. Ils imaginèrent un système savamment organisé pour accommoder cet État investisseur, en hiérarchisant les instruments, certains d’entre eux étant qualifiés de monétaires, avec certaines limites, et utilisés en dernier recours.
- Conceptions normatives
Enfin, si le circuitisme peut être qualifié de doctrine, c’est parce qu’il alla également de pair avec une évolution de la conception du rôle de l’État. Chez les circuitistes, l’État était aussi bien régulateur qu’investisseur et acteur de la croissance. Cette transformation débuta pendant la deuxième moitié des années 1930. Paul Reynaud évoqua dans son discours de 1939 un État qui aurait pris une tout autre figure avec la guerre : l’« État-Moloch ». Si cette qualification semble monstrueuse, il jugeait que, dans le contexte de la guerre, « l’État-Moloch a raison. » ; il prédit que celui-ci ne sera pas maintenu après la guerre, mais que le rôle de l’État connaitrait une évolution profonde. Il devrait continuer à jouer un « rôle capital », « maintenir, dans l’après-guerre, la coopération du capital et du travail qui aura permis la victoire ».
Cette évolution fondamentale transparut ensuite pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les écrits de Francis Delaisi [23]. Selon lui, il fallait changer de paradigme en ne finançant plus les dépenses de l’État a posteriori, une fois des ressources dégagées, mais a priori : « Ainsi se dégage une méthode nouvelle, exactement inverse de l’ancienne. Au lieu d’attendre, pour construire une maison, d’avoir rassemblé de quoi la payer, on a construit d’abord, et réalisé le capital ensuite. Solution logique en somme, car l’effort de travail a toujours précédé la création de toute richesse. Au lieu de s’appuyer sur l’épargne – fruit du travail passé – on a anticipé sur le produit du travail en cours. Du même coup on s’est affranchi de la tutelle du capital, ou mieux de son détenteur. » (1942). Ce renversement est clé, car dans le système qu’il propose il considérait qu’un investissement public pouvait être productif et permettre la constitution d’un « capital », ce que ne considéraient pas les libéraux et les néolibéraux.
Après la Deuxième Guerre mondiale, François Bloch-Lainé, qui fut l’un des plus grands architectes du circuit, alla encore plus loin en développant l’idée qu’il existait finalement une frontière assez floue entre le secteur public et privé. Il ne considérait pas simplement le circuit comme de l’ingénierie financière, mais comme allant de pair avec une nouvelle conception de « l’économie concertée », qui résoudrait les querelles « entre les partisans de la libre entreprise et ceux des interventions de l’État » (1953). François Bloch-Lainé conclut que dans cette nouvelle organisation : « La conception moderne des dépenses publiques considère comme erronée l’image d’un État parasite absorbant pour lui-même une part de la substance nationale : car l’État n’est qu’une idée juridique, mais non pas une réalité matérielle. Il n’y a pas de dépenses de l’État (…), car l’État n’existe pas. » (Ibid.). Il convient toutefois de souligner qu’il s’agissait d’une vision en circuit fermé, qui impliquait de se reposer davantage sur l’épargne nationale que sur les fonds des investisseurs internationaux.
La vision d’un État investisseur était d’ailleurs enseignée par Pierre Mendès France dans ses cours de l’ENA en 1950, selon qui : « Il ne suffit pas d’entretenir l’appareil productif, il faut en toutes circonstances l’améliorer ». Il ajouta que « le remplacement constant de machines meilleures, plus modernes et d’une productivité supérieure » était la condition du « progrès » qui s’opposait à « la stagnation », au « piétinement de l’économie » et à se laisser « dominer » par d’autres nations.
Cette différence de conception de l’État impliquait une différente approche du marché. Puisqu’il n’existait pas, selon les circuitistes, d’opposition nette entre un secteur « public » et « privé », la notion de concurrence entre les besoins publics et privés était moins pertinente, ainsi que l’idée que l’État devrait être soumis à une discipline de marché.
La doctrine néolibérale (milieu des années 1960 – aujourd’hui)
Comme mis en évidence par Benjamin Lemoine (2016), à partir du milieu des années 1960, le circuit fut progressivement démantelé. Quels furent les arguments mis en avant après la Deuxième Guerre mondiale qui menèrent à cette deuxième transition vers une nouvelle doctrine de la dette ?
C’est l’économiste Jacques Rueff qui s’imposa comme le principal pourfendeur des instruments de financement hors marché. Il fut aussi celui qui défendit la technique de l’adjudication de bons du Trésor à court terme sur le modèle britannique, qu’il avait étudiée dès les années 1920. Il poussa à une réforme du financement public dès l’après-guerre, même si celle-ci ne commença à se matérialiser qu’à partir des années 1960. Jacques Rueff s’appuya sur un ouvrage séminal, L’ordre social, qu’il écrivit pendant la guerre et publia en 1945. Il arriva à ses fins. Alors que les taux étaient auparavant fixés par l’Etat, la première adjudication de bons du Trésor eu lieu en 1963 [24], et cette technique de financement devint progressivement dominante.
Le passage de la doctrine circuitiste à néolibérale de la dette ne fut pas fondé sur des théories monétaristes. Les raisonnements de Jacques Rueff s’appuyèrent sur une doctrine antérieure à la Première Guerre mondiale, la doctrine des effets réels, qui dominait notamment à la Banque de France. Le financement hors marché était selon lui inflationniste car il était créateur de « faux droits » (Rueff 1945), c’est-à-dire des droits sans valeur sous-jacente dans l’économie réelle. Cette notion constitua le socle de sa critique du financement public. Selon lui, l’État, en cherchant à se financer, était à l’origine d’une déconnexion entre les instruments de financement et l’économie réelle. Ces « faux droits » étaient selon lui à l’origine de l’inflation. Mais pour fonder ce raisonnement, il utilisait un langage davantage d’ordre moral que scientifique au cours de sa démonstration : les faux droits seraient « mensongers » (ibid.), et l’État devrait corriger ce mensonge (ibid.) [25].
Ensuite, la doctrine néolibérale était caractérisée par la défense des adjudications de bons du Trésor à court terme. Pour Jacques Rueff, le financement public devait se faire selon les lois du marché et non pas avec des taux définis par l’État, ou avec des planchers de détentions des banques. Son objectif était de réduire au minimum les dépenses de l’État ; qui deviendraient soumises à la discipline de marché [26]. S’il défendit les adjudications, c’est parce qu’il jugeait que cette forme de dette à court terme pouvait se liquider d’elle-même. Il pensait qu’une discipline de marché serait imposée, qui forcerait à réduire le déficit budgétaire, et que cette dette servirait seulement à satisfaire les dépenses minimales de l’État.
Cette doctrine ne saurait ainsi être comprise comme un simple retour au libéralisme. En effet, si les néolibéraux cherchaient à réduire les dépenses de l’État comme les libéraux, ils considéraient que grâce aux adjudications, l’État n’aurait plus à discipliner lui-même. L’adjudication était un « mécanisme de précision » [27] redoutable qui forcerait l’État à réduire ses dépenses publiques au strict minimum.
Conclusion
Cette histoire des doctrines de la dette publique montre que les modes de gestion de la dette ne sont pas stables, mais qu’ils évoluent avec le temps et les enjeux. Où nous situons-nous aujourd’hui dans cette histoire ? Sommes-nous en train d’observer des évolutions de grande ampleur ?
Les études sur l’histoire du financement public se sont récemment multipliées. Elles montrent que l’histoire économique mondiale a davantage été celle d’outils mixtes et d’une coordination entre Trésors, banques centrales, agences publiques hors bilan et marchés que de l’application de pure gestion de marché de la dette (voir par exemple Bateman 2023 ou Murau 2023a). Depuis la crise de 2008, l’idée que le financement public pourrait se reposer entièrement sur des mécanismes de marché a d’ailleurs été bien remise en question avec les politiques monétaires non conventionnelles et le retour d’un débat sur les mécanismes de redirection d’épargne. Nous sommes finalement en train de faire l’expérience d’un moment de recomposition. Les pratiques ont précédé en partie les théories, mais les théories essayent de prendre acte de ces changements de pratiques pour penser un nouveau système possible qui doit encore être stabilisé. Quelles pourraient être les conditions d’un véritable basculement pour renforcer la coordination institutionnelle, diversifier les outils de financement et financer la transition ? Nous avons proposé une réponse dans notre article Une théorie du changement.
Cet article est un résumé de la thèse de l’autrice dirigée par Annie Cot et Eric Monnet qui sera bientôt en ligne.
Pour découvrir une étude du cas Allemand réalisée par notre partenaire Dezernat Zukunft : Sovereign Debt Issuance and the Transformation of the Monetary Architecture in Prussia and the German Empire, 1740–1914.
Clara Leonard
Image : Konstantin Yuon, People, huile sur toile, 1923.
Bibliographie
Bateman, Will. “The Fiscal Fed.” SSRN, 2023.
Baubeau, Patrice, et David Le Bris. “La deuxième guerre mondiale.” Dans Une histoire de la dette publique en France, dirigé par Michel Lutfalla, 159-177. 2019a.
Baubeau, Patrice, et David Le Bris. “La IVe République.” Dans Une histoire de la dette publique en France, dirigé par Michel Lutfalla, 179-207. 2019b.
Bloch-Lainé, François. A la recherche d’une économie concertée. Les éditions de l’épargne, Paris VI, 1959, 23 p.
Delaisi, Francis. La Révolution Européenne. Paris: Les Éditions de la Toison d’Or, 1942.
Eichengreen, Barry, et Ruis Esteves. “Up and away? Inflation and debt consolidation in historical perspective.” Oxford Open Economics, Volume 1, 2022.
Gide, Charles, et Charles Rist. Histoire des doctrines économiques : Depuis les physiocrates jusqu’à nos jours. Réimpression de la 6e édition de 1944. Paris : Dalloz, 2000.
Lemoine, Benjamin. L’ordre de la dette, Enquête sur les infortunes de l’État et la prospérité du marché. Paris : Éditions de la découverte, 2016.
Margairaz, Michel. Chapitre XVII. “Le premier Vichy : l’engrenage dirigiste et ses ambiguïtés (juillet 1940-avril 1942)”, dans L’État, les finances et l’économie. Histoire d’une conversion 1932-1952. Volume I. Vincennes: Institut de la gestion publique et du développement économique, 1991.
Mendès France, Pierre. Financer la Reconstruction de la France : Problèmes économiques et financiers que pose la politique des investissements et de la reconstruction en France. Cours commun, ENA, promotion “Europe”, 1950. Nouvelle édition [en ligne]. Paris: Institut de la gestion publique et du développement économique, 2023.
Monnet, Éric. Controlling Credit: Central Banking and the Planned Economy in Postwar France, 1948-1973. Cambridge University Press, 2018.
Murau, Steffen. “Sovereign Debt Issuance and the Transformation of the Monetary Architecture in Prussia and the German Empire, 1740–1914.” Publié le 28 juillet 2023 sur le site internet de Dezernat Zukunft.
Murau, Steffen. A Macro-Financial Model of the Eurozone Architecture Embedded in the Global Offshore US-Dollar System. GEGI Study 2020.
Quennouelle-Corre, Laure. La direction du Trésor 1947-1967 : L’État-banquier et la croissance. Vincennes : Institut de la gestion publique et du développement économique, 2000.
Reinhart, Carmen M., et M. Belen Sbrancia. “The liquidation of government debt.” Economic Policy, 30(82), 2015, p. 291-333.
Reynaud, Paul. La Guerre, notre plan économique et financier, discours prononcés le 13 décembre 1939 à la chambre des Députés, le 28 décembre 1939 au Sénat, service patrimoine de la bibliothèque d’Avignon.
Rueff, Jacques. L’Ordre social. Plon, 1945.
Sargent, Thomas J., et Neil Wallace. “Some unpleasant monetarist arithmetic.” Quarterly Review of the Federal Reserve Bank of Minneapolis, 5(3), 1981, p. 1-17.
Notes
[1] Administratives, journalistiques, des mémoires, des essais d’économistes ou encore des revues.
[2] Annie Lou Cot et Jérôme Lallement, préface à la sixième édition (2000).
[3] Charles Gide et Charles Rist (1944).
[4] La rente perpétuelle est un titre public sans échéance de remboursement du capital, mais avec le versement d’intérêts réguliers et fixes.
[5] Il s’agit de la dette à court terme (moins de trois ans), composée à la fois des bons du Trésor, des bons de la Défense nationale, des avances de la Banque de France et des dépôts de fonds (dette « à vue ») à la Caisse centrale du Trésor et dans les trésoreries générales.
[6] Il s’agit d’un principe économique dominant en France au XIXe siècle selon lequel la valeur de la monnaie serait dérivée de métaux précieux.
[7] Pendant l’entre-deux-guerres en France c’était la théorie quantitative de la monnaie (voir chapitre 1) qui était la plus invoquée pour expliquer l’inflation (Chelini 1998, 83).
[8] Pierre Quesnay (1895-1937) : élève de Charles Rist, directeur du service des études économiques de la Banque de France (1926-1929), directeur général de la Banque des Règlements internationaux (1930-1937).
[9] Jean Tannery (1878-1939) : chargé de la guerre économique conte l’Allemagne (1914-1918), Directeur de la Comptabilité publique (1923-1925), directeur général de la Caisse des dépôts et consignation (1925-1934) et de la Caisse autonome d’amortissement à partir de 1926, gouverneur de la Banque de France (1935-1936), président du conseil d’administration de la banque de l’Union parisienne (1937-1939).
[10] Jacques Rueff (1896-1978) : École des sciences politiques puis École polytechnique (1919), élève de Clément Colson, Inspecteur des finances, chargé de mission auprès de Raymond Poincaré (1926-1928), attaché financier à l’ambassade de Londres (1929), directeur du Mouvement général des fonds (1936-1939), sous-gouverneur de la Banque de France (1939-1941), membre de la Société du Mont Pèlerin (1948), Juge de la Cour de justice européenne (1958-1962), préside le Comité d’experts chargé d’étudier la façon d’assainir les finances publiques (1958) qui mène au plan Pinay-Rueff, Comité Rueff-Armand pour la suppression des obstacles à l’expansion économique (1960).
[11] Charles Rist (1874-1955) : docteur en droit (1898), professeur d’économie politique à la faculté de droit de Montpellier (1899-1913), membre de l’équipe Lichtenberger qui regroupe des spécialistes des questions allemandes (1914-1918), membre du Comité des experts (1926), sous-gouverneur de la Banque de France (1926-1929), membre de l’Académie des sciences morales et politiques (1928).
[12] Robert Lacour-Gayet (1896 – 1989) a passé du temps aux Etats-Unis en tant que représentant financier de la France (1924 -1930), et a joué un rôle important dans les négociations de l’accord Mellon-Berenger qui concerne la dette française envers les Etats-Unis. Il est le frère de l’économiste libéral Jacques Lacour-Gayet.
[13] Lorsque les gouvernements s’appuient sur les banques centrales pour financer le déficit budgétaire sans tenir compte des conséquences inflationnistes.
[14] On parle de « répression financière » pour évoquer la pratique des gouvernements qui consiste à prendre des mesures réglementaires pour orienter l’épargne privée vers ses caisses au détriment des acteurs privés. Barry Eichengreen et Rui Esteves ont parlé de répression financière pour évoquer la période de 1947-1956 : « en France, l’assainissement budgétaire s’est donc accompagné d’une répression financière, en obligeant les banques à maintenir, voire à augmenter leurs stocks d’obligations d’État.”, tout en précisant tout de même que les mesures de planchers furent présentées comme étant anti-inflationnistes (voir chapitre 3).
[15] Plutôt qu’elles ne résultent d’une confrontation directe de l’offre et de la demande, tel que c’est le cas lors d’une adjudication.
[16] Ces correspondants se divisent en plusieurs catégories. Il y a tout d’abord les institutions financières et bancaires sous la tutelle du Trésor (Caisse des dépôts et Consignation, Caisses d’épargne, Crédit agricole, Crédit National, Crédit foncier). Il existe également des institutions dont la trésorerie est gérée par l’État (budgets annexes, établissements publics et semi publics, collectivités locales, les Postes, Télégraphes et Téléphone (PTT), et les fonds particuliers déposés au Trésor).
[17] Président du Conseil des ministres français 8 novembre 1934 – 1er juin 1935.
[18] Dette dite « précaire » et dette envers les banques d’émission.
[19] Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l’organisation du crédit. Les articles importants pour notre sujet sont les suivants :
– Article 1 : A compter du 1er janvier 1946, la Banque de France est nationalisée. Elle continue à assurer seule l’émission des billets de banque sur l’ensemble du territoire métropolitain. Les actions de la Banque sont transférées à l’État, qui les détient en propriété. Les conseillers et censeurs désignés par les actionnaires cessent d’exercer leurs fonctions le 31 décembre 1945.
– Article 6 : Sont nationalisées dans les conditions fixées par les articles 7 à 10 ci-après, le Crédit lyonnais, la Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France, le Comptoir national d’escompte de Paris, la Banque nationale pour le commerce et l’industrie.
[20] Ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 portant obligation pour les banques, établissements financiers et certains organismes de déposer en comptes courants les bons du Trésor leur appartenant. JORF du 14 avril 1945. Suivie du décret du 20 avril. Selon Laure Quennouelle-Corre : « Du fait de son caractère inflationniste, le recours au financement par le système bancaire, via les bons du Trésor en compte-courant, est officiellement écarté par le Trésor « dans toute la mesure du possible » » (Quennouelle-Corre 2000, 39). Celle-ci s’appuie sur la source : AEF, fonds Trésor, B 51 015, note sur l’évolution de la trésorerie de 1945 à 1951, n. s., n. d.
[21] Ordonnance du 13 avril 1945, Article 1er : Les banques, les entreprises et établissements financiers qui font profession habituelle d’accomplir les opérations visées à l’article 27 de l’acte dit loi du 13 juin 1941 ; les banques et les caisses dotées d’un statut légal spécial ; les agents de change ; les courtiers en valeurs mobilières, ainsi que leurs chambres syndicales doivent déposer à la Banque de France, les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 500 000 fr.
[22] Traites accordées par le Trésor à des entreprises pour régler certaines taxes au lieu de payer directement l’impôt.
[23] Francis Delaisi (1873-1847) : journaliste économique, anarchiste pendant la Première Guerre mondiale, il évolue ensuite dans les cercles réformateurs pendant l’entre-deux-guerres. Il est alors dans les milieux syndicaux et devient militant pour la Société des Nations. Il collabore cependant après la défaite. Il est incorporé aux Conférences du Groupe Collaboration. Entre 1940 et 1944 il publie des articles dans L’œuvre de Marcel Déat. Il est également membre du comité directeur de la Ligue de pensée française dans la mouvance du Rassemblement national populaire.
[24] Les taux étaient auparavant fixés par l’État.
[25] « Seul aura été laissé à l’État le choix des méthodes, conscientes ou inconscientes, expresses ou tacites, volontaires ou spontanées, par lesquelles sera corrigé le mensonge qu’il a commis en laissant subsister des droits dont il avait dissipé le contenu. »
[26] Jacques Rueff n’utilise pas ce terme comme tel mais nous montrons que c’est l’idée qu’il défend.
[27] Lettre de Jacques Rueff à Jean Saltes du 18 mars 1957, AWB, 2BA52, Dr7. Citée par Olivier Feiertag. Chapitre XIII. Le gouverneur au ministère des Finances : viscosité du système financier et de la société française (1959-1962) In : Wilfrid Baumgartner : Un grand commis des finances à la croisée des pouvoirs (1902-1978) [en ligne]. Vincennes : Institut de la gestion publique et du développement économique, 2006.